L’humain est-il fait pour la course ?

La question de savoir si l’humain est naturellement conçu pour courir soulève un débat fascinant, mêlant biologie, évolution et santé. En observant la nature, il devient évident que la course n’est pas une activité universelle ou essentielle pour tous les animaux. La majorité des mammifères qui se déplacent rapidement utilisent une locomotion à quatre pattes, où deux membres arrière assurent la propulsion, tandis que les deux membres avant servent à la réception ou à d’autres fonctions. Certains animaux comme le kangourou ou le lapin sautent avec leurs puissants membres postérieurs, mais leur morphologie est spécialement adaptée à cette forme de déplacement.
La course chez les animaux
Nos amis les bêtes comme on dit on des moyen de déplacement rapide propre à eux. Toujours en utilisant au moins 2 pattes en même temps pour se propulser ou sauter, leurs muscles et articulations sont le produits de l’évolution et sont parfaitement adapté à leurs modes de propulsions.
Guépard (course à grande vitesse) :

Le guépard est spécialisé dans la course rapide sur de courtes distances. Sa locomotion repose principalement sur une phase de sprint où il utilise une technique appelée « course bipède à propulsion par extension du corps ». Lorsqu’il court, ses pattes arrière puissantes se propulsent en extension explosive, lui permettant d’atteindre des vitesses pouvant dépasser 100 km/h. La biomécanique de cette course implique une utilisation efficace des muscles extenseurs, un alignement optimal des articulations pour maximiser la force de poussée, et une phase de suspension courte pour minimiser la perte d’énergie. La colonne vertébrale flexible joue aussi un rôle crucial en permettant au corps de s’étendre et de se contracter, augmentant ainsi la longueur de foulée.
Kangourou ou lapin (saut) :

Les kangourous et lapins utilisent principalement un mode de locomotion basé sur le saut. Leur biomécanique repose sur la compression et la relâchement des muscles et tendons puissants, notamment dans leurs pattes arrière. Lorsqu’ils sautent, ils stockent l’énergie dans leurs tendons élastiques lors de la phase d’atterrissage, puis la libèrent lors du saut suivant, ce qui leur permet d’économiser beaucoup d’énergie. Ce mode de déplacement est très efficace pour couvrir rapidement de longues distances avec peu d’effort musculaire direct, grâce à l’élasticité des tendons. La posture verticale du corps facilite également le stockage d’énergie dans les tendons.

Le course du cheval un cas à part

La course du cheval, qu’il s’agisse du pas, du trot ou du galop, reflète ses mouvements naturels en tant qu’animal à quatre pattes. Le pas est une marche lente et régulière où chaque patte se déplace de manière alternée, permettant au cheval d’avancer en toute stabilité. Le galop, quant à lui, est une allure plus rapide et dynamique, caractérisée par une phase de suspension où toutes les pattes sont momentanément en l’air, ce qui témoigne de sa capacité naturelle à courir rapidement. Le trot, en revanche, est un mouvement rythmé où les diagonales des jambes avancent simultanément ; il est souvent appris par l’homme car il offre un bon compromis entre vitesse et contrôle.
Biomécaniquement, le trot est particulier car il sollicite de façon équilibrée les muscles et articulations du cheval, permettant une locomotion efficace tout en étant moins fatigant que le galop. En somme, ces allures illustrent la capacité innée du cheval à se déplacer rapidement et efficacement, tout comme d’autres animaux quadrupèdes, mais certaines comme le trot ont été affinées par l’homme pour répondre à des besoins spécifiques.
Une évolution unique : la bipédie humaine
L’humain, quant à lui, se distingue nettement par sa capacité à courir sur deux jambes — une particularité parmi les primates et la plupart des mammifères terrestres. Cette bipédie n’est pas simplement une curiosité anatomique ; elle résulte d’un long processus évolutif. Nos ancêtres ont progressivement adopté cette posture verticale pour diverses raisons : voir plus loin dans la savane, manipuler des outils ou parcourir de longues distances lors de migrations ou de chasses.

Ce passage à la bipédie a profondément modifié notre morphologie : nos pieds sont relativement petits par rapport à notre corps, nos muscles des jambes (quadriceps, mollets) sont moins développés que chez certains animaux spécialisés dans le saut ou la course rapide, et notre centre de gravité est positionné différemment. Contrairement aux félins ou aux kangourous qui disposent d’un système musculaire et squelettique optimisé pour la vitesse ou le saut, l’homme a développé une locomotion bipède qui privilégie l’endurance plutôt que la rapidité pure.
Les répercussions sur la santé

Cette adaptation a ses avantages mais aussi ses limites. La course en tant que telle n’est pas une activité naturelle quotidienne pour l’humain comme elle peut l’être pour un guépard ou un lézard rapide. Courir toute la journée ou tous les jours peut entraîner des risques pour nos articulations — notamment les genoux et les chevilles — qui ne sont pas conçues pour supporter un stress constant dans cette activité.
Cependant, pratiquer la course de temps en temps offre des bénéfices cardiovasculaires indéniables : amélioration de l’endurance, renforcement du cœur et des poumons, meilleure gestion du poids et réduction du stress. La clé réside dans la modération et l’écoute de son corps.
Si tu veux aller plus loin et trouver le type de cardio qui te convient tu peux trouver des informations ici: Le Cardio : Quel type d’entraînement pour quels Objectifs ?
Conclusion : courir oui, mais avec modération

Il semble donc que nous ne soyons pas faits pour courir toute la journée comme le ferait un animal spécialisé. Notre corps n’a pas été façonné pour cela en permanence. Mais cela ne signifie pas que courir soit inutile ou néfaste ; au contraire, lorsqu’elle est pratiquée avec intelligence et régularité, cette activité procure des bienfaits physiques et mentaux précieux.
Et si nous ne pouvons pas rivaliser avec un jaguar en vitesse grâce à nos jambes, nous avons une arme bien plus puissante : notre cerveau. Avec lui, nous inventons des véhicules, construisons des machines et repoussons sans cesse nos limites physiques naturelles.
En somme, l’humain a trouvé sa voie entre endurance et innovation. Courir occasionnellement reste une excellente façon de prendre soin de soi — tout en laissant aux animaux leur place dans leur domaine naturel.
A propos de l’auteur
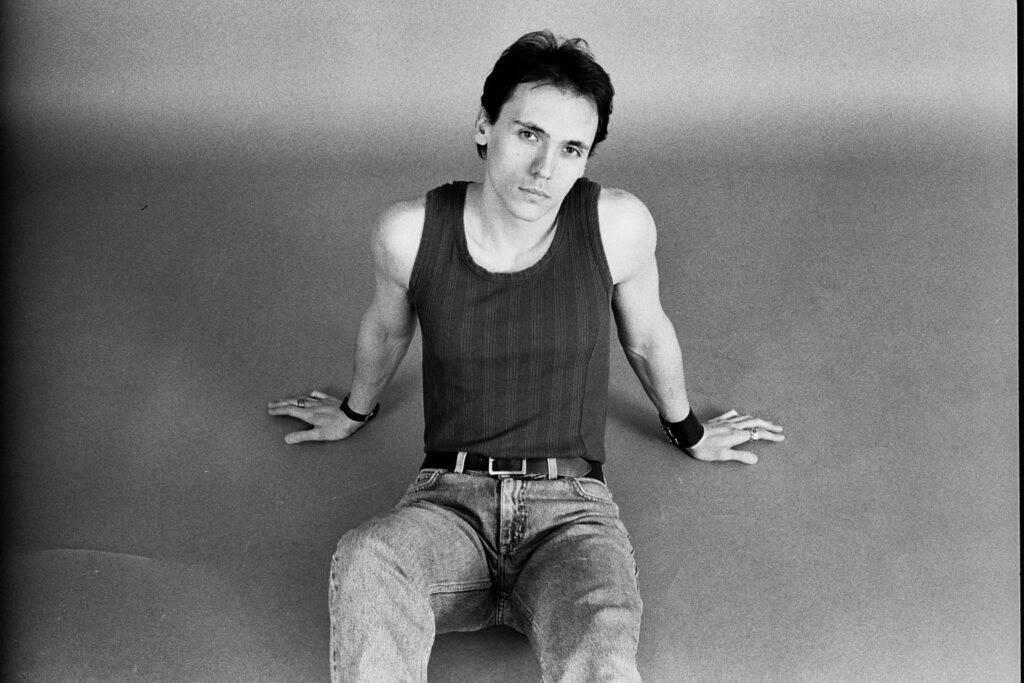
Sam H est coach en nutrition et bien-être. Il accompagne les personnes en quête d’une transformation durable grâce à une approche personnalisée des troubles métaboliques.
Sources
Biewener, A. A. (2003). « Animal Locomotion. »
Liu, J., & Biewener, A. A. (2011). « Biomechanics of hopping in kangaroos and other marsupials. » Journal of Experimental Biology.
Wilson, A. M., et al. (2013). « Biomechanics of the cheetah’s high-speed sprint. » Proceedings of the Royal Society B.
Lovejoy, C.O., et al. (2009). « The origin and evolution of Homo erectus. » Nature Reviews Genetics.
